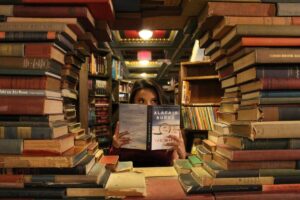Historique et Transformations du Modèle Démocratique
XIXe siècle – Démocratisation de l’éligibilité
Au XIXe siècle, l’accès à l’éligibilité politique s’est démocratisé. Cette évolution s’est construite autour de groupes de pression existants tels que la presse, les parlementaires, les réseaux d’entreprises, les cercles intellectuels, les loges maçonniques, les mutuelles, les sociétés secrètes, les ligues politiques et les groupes religieux (Manin, 1995, « Principes du gouvernement représentatif »).
Après la Seconde Guerre mondiale – Guerre Froide
Durant la seconde moitié du XXe siècle, notamment après la Seconde Guerre mondiale, les systèmes politiques se sont structurés autour de clivages idéologiques forts : gauche contre droite, lutte des classes, opposition public/privé. Les partis se sont ainsi consolidés autour de leurs adhérents, renforcés par des groupes d’intérêts comme les syndicats, les lobbies économiques, les médias, les institutions publiques et privées (Lipset & Rokkan, 1967, « Party Systems and Voter Alignments »).
2008 – Fin des clivages traditionnels Gauche/Droite
Depuis l’élection d’Obama en 2008, on observe un affaiblissement majeur des clivages traditionnels gauche/droite, remplacés par une adhésion aux idées et une gestion communautaire des messages politiques (Castells, 2012, « Networks of Outrage and Hope »). Ce phénomène s’accompagne de l’émergence de pratiques comme la démocratie participative digitale, la co-construction politique et le financement participatif (Crowdfunding).
2017 – Vers une disparition des partis traditionnels
À partir de 2017, avec les élections de Trump aux États-Unis et Macron en France, on assiste à l’effondrement des partis classiques au profit d’une démocratie digitale personnalisée et protéiforme (Gerbaudo, 2019, « The Digital Party »). De grands mouvements transnationaux d’idées et de mobilisations émergent, dépassant les structures traditionnelles. Par exemple, Greta Thunberg a mobilisé 6 000 jeunes Tunisiens âgés de 16 à 25 ans en faveur du climat, un succès qu’aucun parti politique tunisien traditionnel n’a pu égaler.
Des mouvements centrés sur des causes précises gagnent en ampleur mondiale : féminisme, écologie, décroissance, transhumanisme, souverainisme, ou encore des communautés identitaires (black power, islamisme).
En Tunisie, Kaïs Saïed n’a pas provoqué l’effondrement des partis politiques ; il en a plutôt bénéficié et a initié un processus désormais inéluctable et mondial (Chouikha & Geisser, 2021, « Tunisie, une démocratisation au-dessus de tout soupçon ? »).
Critique du modèle démocratique occidental
Le modèle démocratique occidental, longtemps présenté comme exemplaire, montre aujourd’hui ses limites. Aux États-Unis, sur 1723 lois promulguées entre 1997 et 2017, environ 80% favorisent les 20% les plus riches. Seules une centaine de lois bénéficient directement aux populations moyennes ou défavorisées (Gilens & Page, 2014, « Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens »).
Ces tendances sont confirmées en Europe, notamment en France et au Royaume-Uni, où les chercheurs constatent une érosion continue du modèle social, indépendamment des partis politiques au pouvoir. L’augmentation des inégalités illustre clairement la crise structurelle des démocraties libérales occidentales (Piketty, 2013, « Le Capital au XXIe siècle »).
En 2019, 2153 milliardaires possédaient 60% des richesses mondiales. En 2023, ce chiffre est passé à 2760 milliardaires détenant 70% des richesses. La crise du COVID-19 a encore exacerbé ces inégalités, enrichissant davantage les plus riches alors même que l’économie globale ralentissait dramatiquement (Oxfam International, 2023).
En France, les 10% les plus riches détiennent désormais plus de 50% des richesses nationales, alors que près de 10 millions de citoyens vivent avec moins de 1000 euros par mois. Pendant la crise sanitaire, les milliardaires français ont vu leur fortune croître de 30%, captant 80% des aides publiques destinées à soutenir l’économie (Rapport Oxfam France, 2022).
Ces crises sociales, géopolitiques et énergétiques révèlent un modèle occidental en plein effondrement, avec un risque majeur de radicalisation politique vers les extrêmes (Orlov, 2013, « Les cinq stades de l’effondrement »).
Typologies des organisations politiques
Organisation Centric Culture : une logique dépassée
Cette culture autocentrée sur les organisations s’articule autour des intérêts propres à ces entités : partis traditionnels, associations classiques, think tanks conventionnels et entreprises traditionnelles, caractérisées par une logique descendante (« Quelle organisation me convient le mieux ? »).
People Centric Culture : l’avenir de l’engagement politique
Une approche centrée sur les personnes, leurs aspirations et leurs attentes (« Quelle Tunisie souhaite le peuple ? »). INTILAQ 2050 incarne cette démarche en privilégiant une gouvernance participative, fondée sur les attentes réelles des citoyens et sur des pratiques innovantes d’engagement politique direct et inclusif.
Perspectives et risques futurs
L’avenir politique sera marqué par des formes d’expression protéiformes : communautés citoyennes agiles, collectifs numériques dynamiques et plateformes électorales flexibles. Cependant, ces formes politiques nouvelles pourraient s’avérer vulnérables aux influences extérieures, comme illustré par le rôle de l’Open Society de George Soros dans diverses communautés internationales, y compris en Tunisie depuis 2011 (Herman & Chomsky, 1988, « Manufacturing Consent »).
Notre défi est donc de redéfinir collectivement les modes d’expression politique, conciliant notre patrimoine culturel tunisien et les aspirations nouvelles des jeunes générations pour garantir une représentation authentique, autonome et résiliente face aux influences externes.